Et si réunir des gens était un art ?
J’ai enfin lu (et fiché) le livre de Priah Parker, The art of gathering, qui est une des références les plus citées dans le monde de la facilitation. Parker, elle-même facilitatrice, formule dans cet essai clair et accessible la thèse suivante : rassembler des gens n’est pas une expérience anodine. Vous leur demandez de vous confier une de leur ressource la plus précieuse : leur temps. Il est donc nécessaire d’y mettre de l’intention et de designer votre évènement, en assumant une certaine posture d’autorité. Car les bonnes choses n’arrivent pas par hasard.
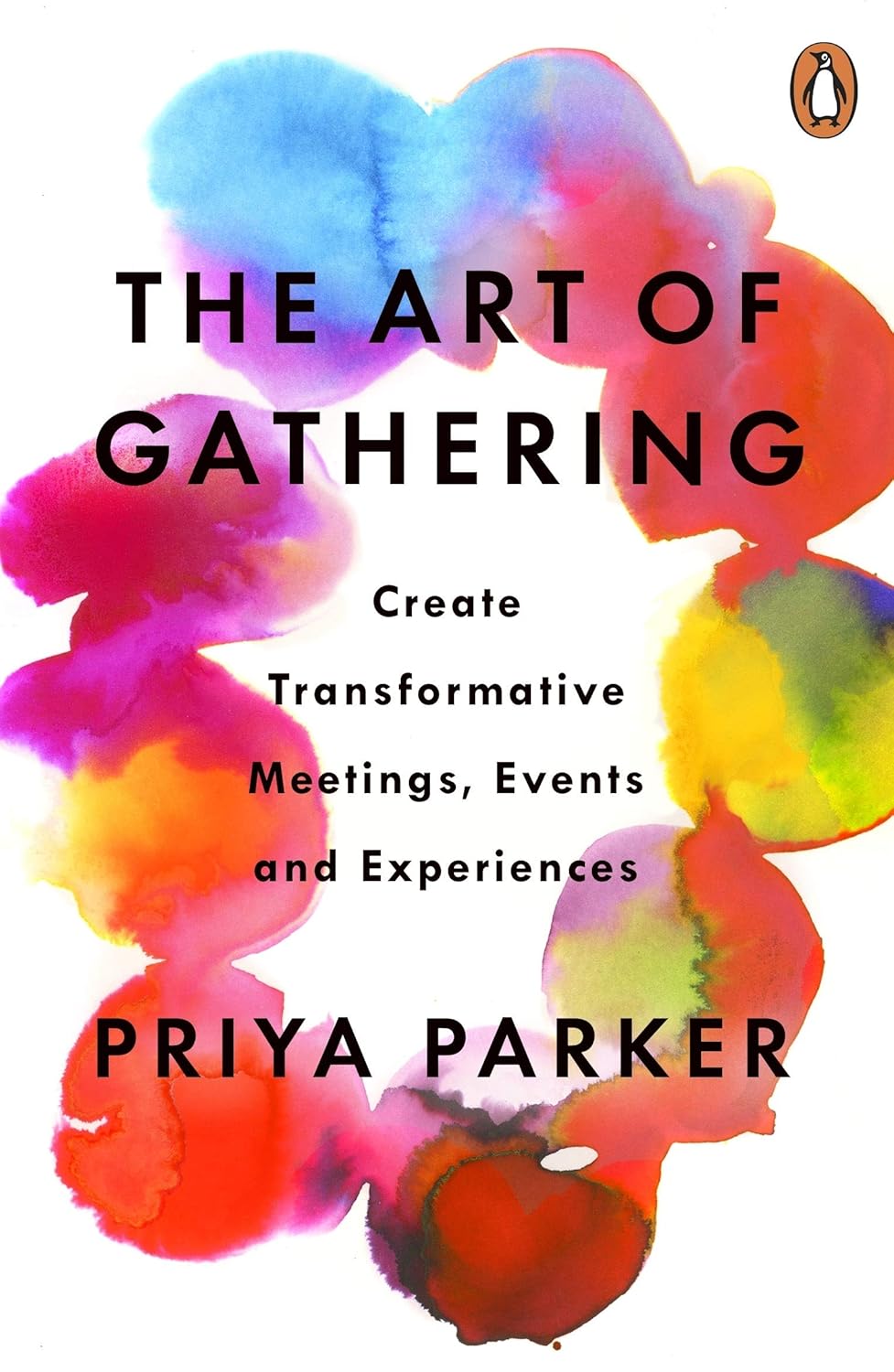
Ce livre est un traité sur comment organiser votre marriage, votre prochaine fête, ou votre séminaire. Son originalité vient justement de prendre au sérieux cette idée simple de “gathering” : rassemblement, réunion, évènement. Tout moment collectif qui comporte des enjeux. Et de proposer une approche ambitieuse qui s’applique à toutes ces occasions. Il alterne considération générale, propositions de changement de regard, anecdotes et conseils très concrets.
En 1 minutes, les points clés :
- Un bon évènement a une intention claire : on peut dire pour quoi on l’organise, de façon précise, concrète et différentiante
- Il est essentiel de bien designer son évènement, depuis l’invitation, jusqu’à sa clôture, voire sa prolongation
- Il est important de faire des choix forts : refuser les participants qui ne sont pas pertinents par exemple
- Vous devez assumer votre rôle d’hôte et l’autorité qui va avec, pour protéger vos invités et leur faire vivre une expérience positive
En 12 minutes,
une synthèse partielle et partiale, qui suit la structure du livre :
1/ Décider pourquoi on se réunit vraiment
La première étape est à la fois la plus évidente, mais aussi celle qui est le plus souvent mise de côté : définir “pour quoi” vous souhaitez organiser cet évènement. En tant que facilitateur, c’est une question essentielle, qui tend parfois au mantra – jusqu’à l’agacement – “quelle est ton intention ?”. Que souhaites-tu, qu’attends-tu de cette journée, de cette séquence, de cet exercice ?
Une des richesses du livre de Priah Parker, c’est qu’elle propose d’appliquer ce questionnement à tous les évènements que vous pourriez organiser (ou, disons, ceux qui ont une certaine importance). Votre prochaine fête, une journée avec des amis, un mariage.
Quelle est votre intention, avec cette fête pour vos 40 ans ?
Commençons par les mauvaises réponses :
- Les catégories ne sont pas des intentions : “fêter mon anniversaire”, ça ne va pas nous aider.
- La platitude doit être proscrite : “passer un bon moment”, “un mariage sur le thème de l’amour”… idem, ça n’aide pas.
- Chercher à plaire à tout le monde n’est pas non plus le plus pertinent. On préférera “un temps pour se rappeler à quel point la vie est courte et combien il faut en profiter maintenant” à “un temps pour célébrer le temps qui passe et accueillir l’avenir”.
- Chercher à tout régler ou au contraire être trop modeste pour ne serait-ce que formuler une intention.
Alors que faire ?
- Prendre du recul et avoir une perspective plus large, comme ce professeur de chimie qui passe de “enseigner la chimie” à “offrir aux jeunes une relation pour la vie avec le monde organique”. Tout d’un coup, on voit des possibles s’ouvrir !
- Creuser, bien sûr, avec les 5 pourquoi. Fêter mes 40 ans. Pourquoi ? Réunir les amis chers et faire la fête ! Pourquoi ? Parce qu’on se voit pas souvent et que le temps file ! Pourquoi ? Parce qu’on vieillit et qu’on devient trop sérieux ! Pourquoi ? Parce qu’on a oublié qui on était quand on avait 20 ans… Ah ! “Un moment pour se retrouver avec ceux qu’on aime et se rappeler à quel point on a su s’amuser quand on avait 20 ans !”
- Penser à l’envers, en partant de la fin et en se demandant ce qui doit sortir de l’évènement. Pour cela, vous pouvez creuser la pratique du cadrage en facilitation (voir par exemple ici).
- Formuler, in fine, quelque chose de spécifique, d’unique et de légèrement clivant.
Organiser un évènement de qualité, c’est faire une infinité de choix. Formaliser un vrai but, une intention claire, c’est se donner à la fois un guide, une inspiration, mais aussi engager un physio et pouvoir rejeter les mauvaises idées qui apparaîtront nécessairement.
Exemples d’intentions claires pour des séminaires :
Construire et éprouver une culture de la candeur au sein de l’équipe
Revisiter pourquoi on fait ce qu’on fait et réussir à s’accorder sur ce sujet
Se concentrer sur la relations compliquée entre les commerciaux et le marketing, qui impacte tout le reste de l’organisation
2/ Fermer les portes
2.1/ Qui ?
C’est, de même, une forme d’évidence, mais de celles qui sont faciles à dire et plus difficiles à mettre en oeuvre : la qualité de votre évènement sera fonction de votre capacité à “refuser” la participation des personnes qui ne sont pas pertinentes.
Nous avons tous vu, de près ou de loin, les réunions dans les grandes entreprises, où 15 personnes, connectées de façon lointaine au sujet et souffrant de FOMO, décident de passer leur temps sur terre à suivre cet atelier sur les nouvelles façon de repenser la fonction RH au sein de l’organisation alors qu’elles n’ont jamais eu aucun lien avec les RH.
Réunir avec intention, ça veut donc dire réussir à fermer les portes. En fermant la porte, on créé la salle, l’espace commun. C’est à la fois concret et c’est métaphorique. “Si tout le monde est de la famille, alors personne n’est de la famille” : c’est pareil pour votre évènement, si tout le monde est invité, au fonds, personne ne l’est.
Parker cite l’exemple d’un étudiant égyptien arrivé dans une petite ville allemande, Giessen, dans les années 60, pour poursuivre ses études. Il remarque qu’il n’existe pas de bar pour les étudiants et décide d’en créer un : le Scarabée. C’est un succès rapide et le bar est très vite plein tous les soirs. On y développe des pratiques un peu à la marge à l’époque, comme le fait de boire les bières directement à la bouteille. La seule condition pour y entrer : montrer sa carte d’étudiant. Alors, le jour où l’adjoint au maire a voulu y faire un tour, un problème s’est posé : est-ce que le bar allait rester fidèle à sa vocation ou accepter le poids du pouvoir politique. Notre étudiant égyptien a gentiment refoulé l’élu et montrer ce qu’était un lieu qui avait une intention forte. 60 ans après, le bar existe toujours !
Notre objectif inconscient – qui va être un ennemi récurrent dans notre quête pour devenir de bons hôtes – c’est le souhait de ne surtout offenser personne. Or, la question à se poser est : envers qui veut-on se montrer généreux ? Les invités en lien avec le sujet et notre objectif, ou… le reste du monde ? Laisser des gens qui n’ont rien à voir avec notre intention s’inviter, c’est le risque de se disperser.
2.2/ Où ?
Une fois qu’on a validé le qui, il faut se poser la question du où.
On le sait, les lieux impactent les comportements. La question à se poser, avant celle de la logistique et du coût, c’est : comment incarner son intention ? Et plus précisément, quels comportements vous voulez voir vos participants avoir ? Faire votre évènement dans l’atelier d’un peintre, dans une chambre d’enfant ou dans le parc des tuileries produira un résultat différent !
La question, au fonds, c’est comment “déplacer” les gens. Comment faire en sorte qu’ils sortent de leurs habitudes, de leur mode de fonctionnement par défaut. Platon, un photographe qui a fait le portrait des plus grands dirigeants de ce monde a une technique pour faire face à leur ego : que ça soit Barack Obama ou Sylvester Stalone, il les fait asseoir sur une simple boîte en bois, toute pourrie. Quand on sait que Poutine, Kim Kardashian, Prince ou Khadafi se sont assis dessus, on se rappelle de sa place dans le monde !
Travailler le lieu doit aussi se faire sur la durée de l’évènement. On sait que changer d’espace aide à mieux mémoriser les séquences qu’on y vit. Je me souviens, par exemple, d’une séquence improvisées dans un séminaire où nous avions fait un module sur la plage, au soleil. Comment, alors, associer chaque étape à une partie de l’espace que vous avez à disposition ?
Un dernier point clé concernant le lieu concerne les réflexion autour de l’espace et de la densité. Rien de pire que d’être à 10 dans un espace de 300 m². On sait pourquoi les discussions les plus sympa dans les soirées se passent dans la cuisine : on a besoin de sentir proches, physiquement, les uns des autres !
3/ Assumer le pouvoir de l’hôte et arrêter de la jouer “chill”
Une attitude agace particulièrement Priah Parker : les hôtes qui, sous prétexte d’être chill, détendus, laissent totalement de côté les obligations liées à leur rôle. Pour elle, le détachement (être chill), c’est de l’égoïsme déguisé en gentillesse. Soyons clair : être hôte, c’est avoir un pouvoir. Prétendre que ce pouvoir n’existe pas en étant détaché des contingence de l’animation de votre évènement ne le fera pas disparaître !
Personne ne veut être invasif, imposer des choses aux autres ou passer pour quelqu’un d’autoritaire (voire, faire un bide en lançant une idée d’activité durant le dîner). Mais en réalité, on ne rend pas les invités plus libres à ne pas assumer son rôle et son pouvoir d’hôte. Les gens qui viennent à votre évènement ont accepté d’être à votre merci. Pas à celle de votre vieil oncle alcoolique.
En réalité, l’exercice d’un pouvoir fait partie du contrat que vous passez avec vos invités. Vous devez proposer des choses et vous assurer qu’elle se passe comme c’est prévu. Laisser faire, c’est, dans les fait, abandonner le pouvoir à qui veut le prendre. Isaiah Berlin disait : “Freedom for the wolves has often meant death to the sheep”.
Alors que faire ? Exercer une autorité généreuse. C’est-à-dire, assumer une guidance forte et confiante… dans l’intérêt des invités. Il s’agit en effet de les protéger. Les protéger les uns des autres, les protéger de l’ennui ou encore de leur téléphone. Il s’agit parfois de s’en prendre une pour le groupe, lorsque vous coupez cet invité qui, malgré la consigne de se présenter en 1 minute, parle depuis 5 minutes. La colère de la personne à qui on dit “chut” est concentrée, là où la gratitude du groupe est diffuse.
Exercer son autorité, c’est aussi jouer les égalisateurs, faire en sorte que les autres systèmes de pouvoir, grades ou prestige, restent à la porte et que tous les participants puissent échanger sur une base égale.
Assumer cette autorité, c’est aussi prendre le risque de mouvements de rejets. Quand Parker propose, lors d’un dîner, aux membres d’une communauté sur le point de créer un mouvement politique, de changer de place entre chaque plat, beaucoup grognent : ils n’ont pas fini leur conversation, ils ont la flemme de bouger. Elle a dû leur rappeler que c’était dur de construire un mouvement si on ne savait pas qui était dedans et que l’objectif était que chacun rencontre un maximum de personnes.
Concrètement, elle a dû défendre le futur moi des participants, ravi d’avoir fait des nouvelles rencontres, surpris des connections avec des gens si différents, contre leur moi présent et ses demandes.
Finalement, dans un évènement que vous organisez, vous êtes le boss ! Une réception, ce n’est pas une démocratie. C’est comme dans le design. Les structures aident à produire de bons évènements, comme les restrictions permettent de produire de bon design.
Ce rôle est nécessaire, car les connections, ça n’arrive pas par magie. Vous devez designer pour qu’elles se produisent (par exemple en proposant de changer de table entre chaque plat, ou en formalisant un plan de table en veillant aux intérêts communs des futurs voisins), créer les conditions matérielle idoine (du vin et de la nourriture en généreuse quantité), mais aussi jouer un rôle le moment donné (”Faites BEAUCOUP de présentation des gens les uns aux autres, mais faites le en prenant votre temps”) et notamment celui de “bad cop”, en n’hésitant pas à rappeler à l’ordre les gens qui ne respectent pas le cadre.
4/Créer un monde temporaire alternatif
Lorsqu’on réfléchit à un évènement “perso”, les premières questions sont souvent logistiques (et Parker nous montre qu’il est essentiel de remettre le sens au centre), mais lorsqu’on réfléchit à des évènement “pro”, les premières questions qui se posent sont souvent tournées autour des séquences, des exercices ou des jeux qu’on pourrait proposer. Internet est plein de bases de donnée d’exercices à proposer (voir par exemple cette recension). Mais au fonds, ce n’est pas cela qui va faire le succès de votre temps collectif.
Un évènement réussi, c’est un monde temporaire alternatif. Or, créer un monde différent, ça ne va pas se faire tout seul ! Au-delà des questions de design, Parker insiste sur l’importance de fixer des règles explicites et partagées pour que le collectif fonctionne bien. C’est un sujet qui nous tient à cœur chez EPIGO (voir par exemple ici) et qu’elle développe dans des directions originales.
Pour des évènements “perso”, il peut s’agir de spécifier le tutoiement, de dire qui on peut ramener avec soi ou de préciser que les téléphones seront interdits durant la journée. Il s’agit, à partir d’une contrainte, de créer pour les participants des libertés nouvelles (pas de téléphone, je suis libre de laisser mon esprit vagabonder !).
Car, ces règles, si elles peuvent parfois paraître factices, viennent remplacer l’étiquette, qui réunit des gens similaires qui partagent un code implicite mais essentiel (comment on mange à table, qui invite le premier au bal, etc.) et qui a vocation à justement exclure ceux qui ne le respecte pas. Expliciter les règles permet au contraire de faire en sorte de pouvoir réunir des gens différents sur une base commune (et discutable !).
Elle cite l’exemple d’une journée qu’elle organisait avec des amis, qui consistait en une grande promenade sur toute une journée, conçue minutieusement en amont. Mais pour que cela fonctionne, certaines contraintes étaient nécessaires et imposées aux participants : être présent du début à la fin, laisser son téléphone de côté, être d’accord pour être vraiment présent et engagé avec le groupe, jouer le jeu… Ces journées étaient de grands succès, car dans un monde de choix infini, choisir une seule chose, se laisser porter pendant toute une journée sans regarder sur son téléphone si une autre activité plus palpitante était possible, laisser de côté l’idée d’alternative… c’est révolutionnaire. La restriction devenait libération !
Exemples de règles :
La loi des 2 jambes (qui vient de l’Open Space Technology) : “si jamais à un moment durant notre temps ensemble vous vous trouvez dans une situation où vous n’êtes ni en train d’apprendre ni en train de contribuer, utilisez vos deux jambes et allez ailleurs”.
Une règle pour créer du lien dans un dîner ou un cocktail : vous n’avez pas le droit de vous servir un verre, quelqu’un doit le faire pour vous. En plus de favoriser les conversations, cela met tout le monde dans une posture de dépendance et de générosité !
Une règle pour favoriser les décision : on n’a pas le droit de poser de questions qui appelle plus d’information, on peut uniquement poser des questions sur les informations qu’on a déjà. C’est une règle posée dans un board qui avait tendance à avoir du mal à prendre des décisions. Alors que tous les éléments étaient envoyés en amont, les dirigeants présent demandaient des précisions, des nouvelles projections, ce qui empêchait de converger. Une fois cette règle posée, les questions sont devenues : “qu’est-ce qui nous bloque pour accomplir ce projet ?”, “qui a un problème avec ça ?” ou “comment pourrait-on se mettre d’accord sur ce sujet ?”, plutôt que “pouvez-vous nous donner le détail des résultats du Q4 ?”.
5/ Comment bien démarrer son évènement
5.1/ En amont
Quand démarre votre évènement ? Au moment où arrive la première personne ?
En réalité, il démarre à partir du moment où vos invités en entendent parler. C’est le “moment de découverte” et c’est à partir de là qu’il faut designer. Car l’état d’esprit que vont avoir vos participants au moment d’arriver va nécessairement avoir un impact sur ce qui se passera. Le “moment de découverte” est aussi en partie celui où le “contrat social” qu’est l’évènement se décide. Vous devez donc travailler durant la phase amont à faire en sorte de clarifier le contrat et de générer l’état d’esprit adéquat chez les invités !
Ce travail amont peut être très élaboré, comme pour les démarche de Track II dialogues, qui réunissent, pendant 3 ans, des leaders de pays en conflit, sur des sessions de 3 jours. Dans ce cas, l’organisatrice prend jusqu’à 2 ans, en amont de la démarche, pour se déplacer et rencontrer chaque personne, afin de démonter que sa posture est juste et qu’elle sera fidèle à sa parole. Il s’agit de construire une confiance auprès de gens qui ont beaucoup à perdre à s’afficher avec des ennemis.
Mais il peut aussi être très simple, comme ce producteur qui organise une soirée de fin d’année et qui n’a pas eu le temps de décorer son arbre de noël. Il demande à chaque invité de lui envoyer 2 photos d’évènements joyeux de leur année. En arrivant, les invités découvrent les photos accrochés dans l’arbre, ce qui a fait un super démarrage !
Une bonne façon de travailler avec vos invités, c’est de leur demander de contribuer à l’évènement sur cette phase amont. Comme dans l’exemple ci-dessus, ou en leur envoyant, comme le fait Priah Parker, un “workbook” numérique, une liste de question à traiter par écrit. Ce workbook a 2 objectifs :
- Les amener à se connecter à leur propre intention, en lien avec l’évènement (”pourquoi est-ce que vous avez rejoint cette entreprise ? ce projet ?”)
- Les amener à partager honnêtement au sujet du challenge qu’ils vont tenter de relever (”qu’est-ce qui vous inquiète dans cette nouvelle stratégie ?”)
Le résultat de ces questions sera ensuite partagé en séance, on y reviendra.
Il s’agit donc de designer (l’invitation, le nom de l’évènement, les échanges amont avec les invités… tous les points de contacts !) et d’impliquer les participants, dès le moment de découverte, pour faire en sorte que ceux-ci arrivent dans les meilleures conditions pour ce qu’on a à faire.
5.2/ L’introduction
Le jour J, l’arrivée dans l’évènement doit aussi être travaillée. Il faut créer un seuil, matériel ou symbolique, qui fait que les participants vont passer de leur réalité à votre petit royaume, à ce monde temporaire alternatif. En facilitation, on fait des inclusions. Mais on peut réfléchir à quelque chose de plus expérientiel, qui marque le passage, la transition.
Marina Abramovic, une célèbre artiste contemporaine, proposait des expériences musicales et demandait aux participants, au début de celle-ci, de porter pendant 30 minutes des écouteurs diffusant du bruit blanc. “le silence est quelque chose qui les prépare à l’expérience qu’ils vont vivre”. Comme on mange de la mie de pain entre les dégustation de verres de vin, afin de retrouver une neutralité du palais, il s’agit de permettre aux gens d’être pleinement en posture d’accueil de la nouvelle expérience, et cela consiste souvent dans le fait de “nettoyer” ce qui était présent avant.
Lorsqu’un évènement commence, nous nous posons tous les mêmes questions : qu’est-ce que j’en pense ? est ce que je suis entre de bonnes mains ? est ce que l’hôte est nerveux ? est ce que je dois l’être ? qu’est-ce qui va se passer ? est-ce que ça vaut le coup ? est-ce que je me sens à ma place ? est-ce que j’ai envie d’appartenir à ce groupe ?… Nous sommes dans une posture d’attente, d’évaluation.
Face à ce constant, le conseil de Parker, c’est d’éviter de démarrer notre intro par les considérations logistiques et pratiques. Ce serait en effet rater une opportunité importante : les études montrent qu’on retient d’un discours essentiellement les 5 premiers pourcents et les 5 derniers, ainsi qu’un moment de climax.
Alors comment bien démarrer son introduction ? En proposant une forme de thérapie du choc sympa ! Il faut à la fois impressionner et honorer vos invités. C’est le lobby de l’hôtel du Four Seasons qui accueille ses clients avec des fleurs… plus grandes qu’eux. On est impressionnés, mais aussi honoré de se dire que c’est pour nous. De même quand on arrive dans la boucherie de Dario Ceccini, en Toscane, où on est accueilli avec un verre de vin et où on peut se retrouver invité à dîner avec des amis à lui autour d’une grande table, à côté de sa boutique. Enfin, comme ce prof de compta qui démarrait son année par le fait de nommer chaque étudiant, en la regardant dans les yeux, sans regarder son trombinoscope, preuve qu’il avait fait l’effort d’apprendre par cœur les noms et visage de chacun avant la rentrée. On est impressionné. Et honoré.
Impressionner vous place au dessus des participants. Les honorer vous place en dessous. Faire les deux leur donne l’impression de faire partie d’un club dont il ne devrait pas faire partie (clin d’oeil à Groucho Marx) !
5.3/ Créer le collectif
Il s’agit ensuite de créer le collectif, de faire de la somme des invités une unité. On peut proposer un tour de parole, leur demander de partager quelque chose, faire en sorte qu’ils se connectent les uns aux autres (j’avais testé un format de slow meeting il y a quelques temps, très réussi). On peut aussi leur propose de s’engager à fonctionner selon un état d’esprit donné, comme au démarrage de la Mud Race (”On est là pour en baver, mais dans la bonne humeur”).
Jill Soloway, une dramaturge et metteur en scène américaine a, elle, un rituel sur ses tournages : la boîte. Au début de chaque journée, l’assistant réalisateur va chercher une boîte en bois et la place dans un espace dégagé. Tout le monde se met à entonner : “la boîte, la boîte, la boîte”, jusqu’à ce que l’ensemble du plateau soit réuni autour de la boite et qu’une personne monte dessus. Il s’agit alors de partager ce qu’on a sur le cœur à ce moment là : des soucis avec un vieil ami, un décès dans sa famille, comment on joue en ce moment… Et ainsi de purger des choses avant de démarrer le travail. Cet séquence permet de montrer à chacun que tout le monde est là pour jouer et qu’il n’est donc pas possible d’échouer, ou de se ridiculiser. Ce rituel transforme un groupe d’individus en une tribu, prête à travailler ensemble pour la journée.
Pour finir, ce temps investi pour créer un collectif et faire en sorte que chacun soit conscient de chacun, ce n’est pas de la cosmétique. Une étude américaine de 2001 a montré que lorsque les membres d’une équipe médicale se présentent les uns aux autres en amont d’une opération, les probabilités de complication ou de décès baissaient de 35% !
6/ La meilleure version de vous… n’est pas invitée à mon évènement
Parker a l’habitude de travailler à l’international, sur des programmes réunissant des leaders de différents pays. Des gens importants, aux CVs longs comme le bras. Le problème, c’est que lorsque ces personnes se rencontrent, elles agissent naturellement comme si elles étaient leur propre attaché de presse : elles ne cessent de présenter un profil parfait et mettre en avant leurs réussites. C’est naturel et, d’une certaine manière, nous faisons tous ça. Le problème, c’est que personne ne créé de lien avec un CV, aussi beau soit-il. Ce qui nous lie au gens, ce sont leurs vulnérabilités. Alors, comment faire pour permettre à vos invités de passer en mode super héros, c’est-à-dire à assumer de se dévoiler et de porter leurs sous-vêtement SUR leurs vêtements ?
Sa méthode s’appelle 15 toasts. Il s’agit de proposer à tous les participants de se retrouver la veille au soir pour un dîner informel, dans une ambiance chaleureuse et de proposer un exercice. Chacun doit, à un moment du dîner, porter un toast devant tous les autres, sur un thème donné (”Les moments durs de la vie” ; “Le succès” ; “Une vie bonne”). Le dernier qui passe doit chanter une chanson. L’objectif : que ces toasts soient des prises de paroles sincères, qui permettent aux invités de se dévoiler et de jouer une partition différente de celles qu’ils adoptent en public habituellement.
Pour cela, il faut être explicite dans la consigne : “le but de ce dîner, c’est de tester une autre façon d’être ensemble, de créer un espace pour que chacun puisse montrer une facette différente de soi et jouer un rôle différent. On aimerait que vous partagiez quelque chose qu’aucune des autres personnes présentes n’a déjà entendu sur vous.” On peut aussi, en amont, valider la “qualité de chacun” afin qu’ils puissent montrer leur vulnérabilités (”vous êtes tous là car vous êtes exceptionnels. mais ce n’est pas ce qui va nous intéresser…”). L’environnement compte : lumière tamisée, pièce fermée, bon vin. Les thèmes qui fonctionnent le mieux sont les thèmes sombres : “la peur”, “eux”, “les frontières”, “les étrangers” ; ceux qui permettent de nombreuses interprétations, qui permettent de montrer les parties faibles, confuses, non processées, moralement compliquées de chacun. On peut finalement donner l’exemple et partager en introduction quelque chose d’encore plus personnel que ce qu’on attend des autres.
Mais surtout, ce qu’on souhaite, lors des évènements, c’est que les gens ne partagent pas des idées, mais des histoires. C’est une conviction que j’avais depuis longtemps : les gens sont nuls en théorie… mais excellents en pratique. Laisser démarrer un débat sur les idées et, sauf rares exceptions, vous obtiendrez quelque chose de creux qui aura tendance à cliver, chacun s’identifiant à sa position. A l’inverse, demandez aux gens de partager une histoire, de raconter ce qu’ils vivent ou font et vous aurez du lien… et une production intellectuelle beaucoup plus riche !
7/ Créer de bonnes controverses
“Une bonne controverse, c’est le genre de conversation qui aide les gens à regarder plus précisément ce à quoi ils tiennent, quand il y a à la fois du danger, mais aussi des opportunités à le faire”
Comme pour l’ensemble des choses qui vont faire le succès de votre évènement, il s’agit de travailler en amont au design de votre séquence. Une bonne controverse, productive, n’arrive pas par hasard. Vous devez travailler sur la forme : on peut ritualiser un match de catch, donner des rôles, forcer les gens à prendre parti pour explorer divers points de vue…
En amont, il peut être intéressant de faire une “heat map” des sujets chauds, des thèmes qui peuvent affecter ou menacer les gens, réveiller leurs peurs, toucher à leurs besoins ou à leur estime de soi ou qui ont trait au pouvoir. Cela peut être le marriage gay au sein d’une paroisse, les licenciements à venir dans une usine, le rôle du management dans une organisation toxique… Ce sont souvent les sujets que les gens évitent sans savoir qu’ils les évitent. Il faut évidemment procéder avec tact, mais amener ces sujets sur la table peut faire de votre évènement quelque chose de transformateur. Les sujets chauds permettent en effet de dépasser la couche des échanges polis pour toucher aux valeurs de chacun.
En préparation d’un évènement Priah Parker passe des coups de fils anonymes aux participants, pour aller justement chercher ces sujets chauds, mais elle envoie aussi ce workbook, dont le résultat sera partagé et qui comprend des questions sur ce qui ne fonctionne pas. Par exemple :
- Si vous deviez mentionner quelque chose qui est tabou, ou politiquement incorrect à propos de ce projet, qu’est-ce ça serait ?
- Quelle est la conversation la plus pressante que nous devrions avoir selon vous ?
Avant de lire les réponses, en début de séance, elle pose les questions suivantes : de quoi avez-vous besoin pour vous sentir en sécurité ici ? de quoi avez besoin de la part du groupe pour être d’accord de prendre un risque dans la conversation aujourd’hui ?
8/ Accepter que tout a une fin
C’est difficile de bien clore un évènement. On a souvent tendance à bâcler ces moments, voire à faire comme si ils n’existaient pas et à laisser du flou, peut être par crainte de la finitude des choses. Nous agissons comme ces ex qui finissent par ne pas vous rappeler, sans prendre la peine de rompre avec vous. Or, “guest, like romantic partner, deserve a proper breakup”.
Il faut globalement accepter que les choses ont une fin et ne pas céder aux demandes de prolongement (j’ai toujours eu l’impression qu’un bon évènement se devait d’être un peu trop court, plutôt qu’un peu trop long)
Avant de conclure, on peut proposer un dernier échange, qui comporte 2 phases :
- Un temps pour regarder vers l’intérieur : on prend un moment pour revenir sur ce qui a été vécu, ce qu’a traversé le groupe et le souder une dernière fois.
- Puis on regarde vers l’extérieur, on se prépare à se séparer et à retrouver sa place dans le monde.
Dans le domaine de la résolution de conflit, on parler de “reentry” pour cette deuxième phase. Il s’agit d’aider des gens qui ont vécu une expérience intense, hors de leur univers, à revenir dans leur réalité et dans la situation de conflit. On peut par exemple se mettre d’accord : si on se revoit, comment on se comporte ? Comment on raconte ce qui s’est passé ici ?
L’enjeu est de réussir à trouver un fil, qui va relier les deux mondes, celui de l’évènement et la réalité dans laquelle les participants vont retourner. On peut leur demander de prendre un engagement devant le groupe, d’écrire une lettre à son moi futur (qu’on postera quelques semaines plus tard) ou encore leur offrir un objet qu’ils pourront conserver. L’idée est de pouvoir laisser une trace concrète dans la vie des gens, qui leur rappelle ce qu’ils ont vécu et décidé durant l’évènement.
Enfin, il ne faut jamais finir avec la logistique et les remerciements, mais profiter de l’opportunité pour honorer une dernière fois le collectif. Par exemple ce prof de musique qui, à la fin de ses cours, joue la première notes de la chanson de clôture, la tient, énonce tous les sujets logistiques (n’oublie pas ton sac, rendez-vous à telle heure semaine prochaine, n’oubliez pas vos partitions), puis reprend le morceau et le joue jusqu’au bout. Ou comme ces cérémonies funéraires dont les derniers mots sont : “puisse la source de la paix vous apporter de la paix, ainsi qu’à toutes celles et ceux qui vivent le deuil” ce qui permet de connecter ainsi la souffrance individuelle à la souffrance globale, pour la rendre à la fois plus petite et plus grande.
Conclusion et ouverture
Ce livre est effectivement une superbe démonstration de la nécessité de prendre au sérieux l’acte de réunir des gens, que cela soit pour un dîner ou un séminaire de 300 personnes. Avec une intention claire, du design, des choix forts, on peut faire en sorte que ces moments collectifs créent de la réalité. C’est d’autant plus important que c’est souvent en collectif que nous pouvons montrer notre meilleur (et notre pire) visage, en tant qu’espèce.
En guise de “take away”, quelques questions glanées dans le livre et qui peuvent vous servir pour un menu de conversation (voir cette scène des Monty Python), si vous souhaitez des échanges profonds :
- Qu’avez-vous à l’esprit vous concernant pour l’année qui vient ? Et en ce qui concerne le monde ?
- Qu’est-ce qui vous a amené dans cette ville ?
- Quel livre vous a profondément touché durant l’enfance ?
- Comment vos priorités ont changé sur les dernières années ?
- Comment votre background et votre expérience ont pu être des empêchements ou des atouts dans votre vie ?
- Quelle partie de votre vie a été une perte de temps ?
- Contre quoi vous êtes-vous rebellé dans le passé ? Et contre quoi vous rebellez-vous maintenant ?
- Quelles sont les limites de votre compassion ?
- Un moment de votre vie qui vous a amené à changer de façon de voir le monde ?
Envie d’aller plus loin ?
Découvrez notre offre d’accompagnement dans votre transformation ou dans vos séminaires stratégiques et notre formation sur la facilitation qui revient sur les questions de cadrage.
